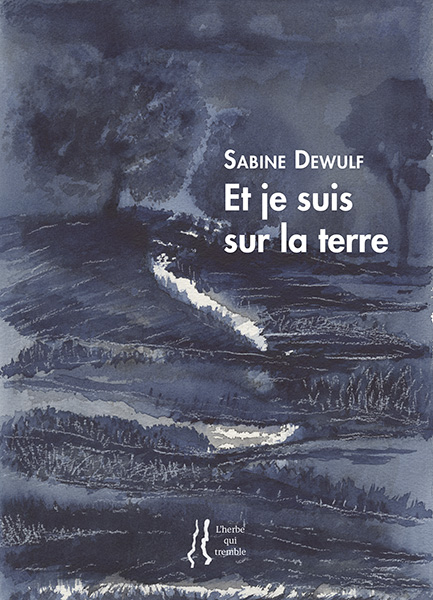Ce billet est destiné aux abonnés qui ne fréquentent pas Facebook. Il en existe quelques uns. La revue en ligne Terre à Ciel me consacre un article composé de 6 textes et un entretien. J’ai plaisir à le partager avec vous. Photo de Une Feggari Xouw
Claire Massart
Dans mes rêves
Les girafes possèdent mes rêves, leur tête couronnée d’oiseaux.
Dans mes rêves passent aussi des amis morts : seuls mes rêves savent qu’ils sont vivants. Ils dérivent, troncs sur le fleuve de mes rêves. Bois flottés.
Les nuages parlent dans mes rêves, avec des voix si différentes, proches des bêlements, plainte ou reproche.
Mes rêves sont des fenêtres que traversent des oiseaux en vols serrés, pressés, bruyants.
Dans mes rêves, il y a des comédiens qui ne savent plus leur texte ; des ombres y titubent en quête de ce corps introuvable.
Il y a aussi des lignes brisées sur une carte, pays imaginaire, oublié. Tracé d’une contrée de l’enfance où se côtoient cactus et océan.
La cible nomade
C’est une image qu’on tente d’épingler
Mais pique-t-on un son, une couleur, un parfum,
Fût-ce avec une épingle à tête rouge ?
C’est une route poussiéreuse, un ciel voilé
Des bâtisses aux flancs lisses et roses
Un vent chaud qui sent la terre.
C’est un enfant accroupi au bord de la route
Un petit tas de cailloux colorés devant lui
Il hurle « Améthyste » à notre passage
C’est un parfum d’eucalyptus
La hauteur folle d’un palmier au tronc fibreux
Les bougainvilliers et les guêpes des sables
Et toujours cette odeur de terre
Je vise mais la cible est nomade et l’oiseau incertain.
On meurt comme on peut
Certains jours lèchent
D’autres lapident.
Une partition de fragments et cassures, de dissonances
On désire l’amnésie comme une amnistie
On a soif : la mémoire altère. Une pépie : l’eau manque.
Retours de rêves anciens : des nourrissons inquiets, un mutisme persistant, des chutes de bicyclettes, des piqûres de guêpes.
On meurt comme on peut. Dans un trop plein d’abandons. La bouche pleine de coton. On meurt en désordre.
On n’a jamais tout dit.
On meurt où on peut : dans une anfractuosité de rêve, dans une vague scélérate, dans un wagon vide.
Ce serait ça : partir sans saluer, les spectateurs sont déjà loin. Partir sans déglutir, gorge saisie dans l’étau de la honte de n’avoir pas su vivre.
La Hutte
Dans la hutte du soir, on grimpe sans lumière.
Juste la lucarne toujours ouverte vers l’intérieur.
Il y a des oiseaux blessés, attrapés à la pipée, qu’il va falloir soigner.
Dans la hutte du soir, on escalade la rumeur.
On monte vers le silence, sans crainte ni hâte.
On s’accroupit dans sa sagesse. Celle du vieillard en nous.
Dans la hutte du soir, l’enfant de toujours bat des mains.
Il jongle avec ses rires et le vent dans les branches.
Demain, on lâchera les oiseaux réparés.
On cueillera les questions.
L’Arène de verre
Dans l’arène de verre où nous balbutions nos combats
Dans les plis du sable pleine peau
Des frôlements de voix que nous piétinons
Des tissus que nous froissons
C’est du chant parlé
Des mots enchâssés
Des verbes au futur
On n’a jamais su écrire sur la ligne
Ça chuchote dans les interlignes
Les mots de derrière les mots
Leur feutre, leur timidité, leur pudeur
Bouche à oreille Bouche à bouche
Qui se souvient d’une bougie ?
Éloigner la lanterne : le passé se méfie de la lumière
L’avenir s’éclaire de sa propre ignorance
Stupides, nous accordons nos pas à ses éclairs, ses mirages
L’oasis toujours recule
Voici ce qui fut ici, cela sera ou ne sera pas…
Le passé est trop grand. Vieil ogre, il a du sang sur les dents.
Quand j’aurai fini de brûler dans mon feu, je lapiderai les cendres.
Lorsque nous aurons fini d’appeler la pitié, nous rirons au son de ce mot.
Lorsque nos peurs se laisseront oublier, il sera temps de mourir.
Nous serons prêts. Cœur rôti.
Le passé est immense. Des volières plein la poitrine, ça palpite.
Lorsque nous le sentirons, nous ouvrirons les volières et partirons avec les oiseaux. Nous mourrons de ne pas savoir traverser l’air. Nous mourrons de tant d’espace. Nous mourrons car nous ne savons pas voler.
Lorsque l’encrier sera vide, nous jetterons toutes nos feuilles par la fenêtre. À quoi bon ces cédilles, ces E dans l’O, ces accords ?
Le présent gobera tout et nous irons sans langage.
Nous mourrons car nous ne savons vivre sans lui.
Nous supplierons les bêtes de nous apprendre le leur mais elles nous ignoreront.
Le passé avale tout. Lorsqu’il nous aura gobés, que nous serons dans son ventre, nous chercherons nos mots.
Nous serons la risée des arbres. Sur quoi sera posé le ciel, maintenant ?
*
Pourtant, nous avions tout. Même la cruauté était jolie. Souvent, le vent était mauve. Nous avions tout : la joie peignait l’air que nous respirions.
Nous avions tout : de l’enfance plein les doigts comme de la confiture, des voyages en bateaux plein les yeux, des musiques sur le rebord de nos paupières, toutes les musiques.
Nous avions tout : les saisons en file indienne, des couchants que nous notions comme des maîtres sévères mais justes, des sangrias rouge sang avec leurs barques d’oranges.
Nous avions sans posséder. Nous avions d’autant plus que nous ne le savions pas.
*
Comme dans les contes, il était une fois ou il y avait une fois, au temps où les bêtes parlaient, le coq avait chanté, les chats avaient dansé, il y a si longtemps mais je m’en souviens très bien. Maintenant que je me calcine. Les flammes ravivent.
Un jour, plusieurs jours, en plusieurs fois, nos yeux s’affaissèrent.
Seuls les bêtes et les enfants continuaient leur farandole.
Mais nous, nous les vignerons, nous les pourvoyeurs du feu pour le froid, de l’eau pour la soif et du vin pour la joie, la gratitude nous déserta. L’ironie vint.
Les cerisiers ne mirent plus le couvert pour les oiseaux. D’ailleurs, les oiseaux…
Cytise et rossignol disparurent de notre vocabulaire.
La perte fut mortelle. Et comme toute mort, définitive.
Nous sommes la risée des arbres.
Entretien avec Clara Regy
Vous avez évoqué la présence -sans doute prégnante- de la littérature dans votre quotidien, quels sont ces auteurs qui vous accompagnent, auteurs et aussi plus particulièrement poètes ? Peut-être pourriez-vous nous dire pourquoi ? Et aussi comment…
Pour les auteurs qui m’accompagnent, trois noms surgissent instantanément : Henry BAUCHAU – sa fulgurante Antigone – , Pierre MICHON – Rimbaud le fils entre autres – et Pascal QUIGNARD : il faut avoir entendu « Midi. Médée médite » avec la danseuse de butô Carlotta Ikeda. Petite digression : je suis passionnée par le Japon où je suis allée deux fois. Ce qui m’amène aux haïkus et à cette phrase de Santoka : La sagesse est de voir le nouveau dans l’ordinaire, en s’accommodant du monde tel qu’il est. Il y a des trésors cachés dans l’instant présent. (c’est moi qui souligne)
Leur point commun, c’est l’absence de lyrisme – pour une amoureuse de musique ! – quelque chose de presque décharné, sec, « à l’os ».
Mais c’est passer sous silence Virginia WOOLF, Edith WHARTON et l’immense Toni MORRISON ! Elles sont là depuis plus longtemps. Et depuis plus longtemps encore, COLETTE et GIONO (merci, maman).
Pour les poètes, les trois noms que j’écris là jaillissent aussi spontanément. : Roberto JUARROZ, Pierre REVERDY et Philippe JACCOTTET. Je regretterai sûrement demain de ne pas avoir cité René CHAR, Jacques VANDENSCHRICK, José ENSCH* et tant d’autres !
Je crois que lorsqu’on écrit de la poésie – à moins de n’avoir pas trouvé sa voix – on ne pense jamais à une possible ressemblance de style avec un autre poète. Simplement, on met ses pas dans les leurs. Ce sont d’indispensables présences, des figures tutélaires. Ce qu’on leur doit, c’est l’éblouissement.
C’est que partant du visible, ils donnent à voir l’invisible. Juarroz dit que le visible est un ornement de l’invisible. Reverdy, lui, affirme que le poète est un four à brûler le réel.
Ce qui me guide, c’est le surgissement de la collision émue entre le réel – le vu, l’entendu, le touché – et son fantôme, son au-delà du miroir. Cette quête éblouie de l’image précise assortie du son juste comme la justesse en musique, dans un au-delà des mots qui sont outils et joyaux.
Juarroz encore : Ineffables moments essentiels lorsque la vision change de degré ou de niveau. Un poème n’existe pas si un de ces moments ne lui sert pas de base.
La Nature avec un grand « N » semble vous inspirer, sous quelles formes cette source d’inspiration (pardonnez-moi cette répétition) prend-elle « sa » place dans vos écrits ? -même si quelques précisions s’imposent : vous m’avez vous-même suggéré cette remarque-.
Je pense à ces mots de Henry David THOREAU, la grammaire mordorée de la nature. Ce qui nous amène au deuxième axe de mon travail.
J’ai été très privilégiée : mes parents étaient, chacun à leur façon, très attentifs à nous faire découvrir la beauté, quelle que soit sa forme. Nous avons eu très tôt le goût, l’appétit du BEAU. Et nous étions encouragés à aller le débusquer dans la plus humble fleur ou l’immense océan, le plus petit nuage ou le bel orage.
Pendant très longtemps, je n’écrivais qu’en voyage, hors de chez moi. Comme s’il fallait me décentrer de mon lieu de vie pour m’ouvrir, élargir ma perception. Car on entre dans le poème avec le corps. On est dans le sensoriel. Les sens et le sens. Et la Nature vous dit tout, absolument tout ! Il « suffit » de faire taire son mental, de laisser les arbres, la rivière, les bêtes vivre leur vie. Être complètement là et totalement amenuisé, abandonné : viennent alors ces côtoiements de mots, une langue à part, dictée par la lumière et le silence intérieur.
Je pense aussi à Monet qui, à la fin de sa vie, va vers l’abstraction parce que l’urgence est dans l’essentiel. Pas de description, pas de fioritures. Cela nécessite et induit une solitude totale. Jusqu’à la disparition.
La Nature n’est pas un spectacle, un décor qui n’existerait que pour nos yeux. Elle nous précède et continue sans nous, avec les oiseaux. Permanence.
Parlez-nous de votre rapport au temps et à son tempo, peut-être est-ce ridicule d’associer temps et tempo, mais je pressentais un lien, entre musique et rythme du temps qui passe. C’est peut-être une erreur… vous me direz.
Et nous voilà arrivés au Temps, durée et mémoire, éphémère et temporalité. Je suis construite de mes souvenirs. Mon enfance marocaine a sans doute contribué à développer une attention particulière à la joie et aux couleurs. Je ne suis pas passéiste. J’ai eu cette chance de vivre dans un ailleurs parfait vu de maintenant. Mais j’attendais toujours. Je suis encore sur le qui-vive. Avec cette impression très forte de passage. Passer, c’est traverser mais aussi faire passer. Alors, vivre, passer le temps, c’est traverser. Comme Jaccottet fait la traversée de la nuit jusqu’à l’aurore.
Et votre suggestion de rapprocher Temps et tempo est très intéressante : je ne saurais vivre sans la musique. Pour moi, un texte a son tempo, il s’inscrit dans un rythme, il a ses respirations, sa ligne mélodique, ses dissonances aussi, parfois. Il DOIT passer l’épreuve de l’oralité. Et se terminer, que l’on sente la clôture comme la dernière phrase d’un morceau. Un achèvement… provisoire.
Comme la plupart des personnes sensibles, je suis hypermnésique. Emplie de ces réminiscences mais complètement présente au présent, présente aux absents. Les premières nourrissent le second, lui permettent d’advenir.
Parfois, avec l’écriture, le temps se fige. C’est un moment hors du grand Chronos. Un instant, on sort de notre finitude.
Je voudrais vous proposer ces mots de Joël VERNET in Celle qui n’a pas les mots
Écrire ne vaut que pour le chant de la vie invisible, engluée dans la terre, mise sous le boisseau. Écrire délivre peut-être de telles voix. C’est sans doute cela l’espérance d’écrire : ouvrir vers l’infini, vers l’impossible, vers l’inconnu, entendre battre le cœur des silhouettes. (les italiques sont voulues par l’auteur)
Et pour terminer, la redoutable question subsidiaire si vous deviez définir la poésie en 3 mots quels seraient-ils ?
Pour les trois mots définissant la poésie, je sèche, je cale, je n’en trouve qu’un (ou deux) : la vie augmentée.
Et je signerai d’un oxymore : La joyeuse mélancolique
* Le lien sur mon blog pour celles et ceux qui ne connaissent pas José ENSCH :
https://lestempesdutemps.com/2020/02/jose-ensch-poete/
Bio : Je suis née au Maroc en octobre 1950. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de onze ans.
(livre de chevet : Robinson Crusoé)
Adolescence = lecture, lecture, lecture. Découverte de la poésie : Saint-Pol Roux, Saint John Perse et tous leurs saints…
Études de Lettres Modernes à Bordeaux et à Paris.
Puis, je suis vigneronne pendant sept ans dans le saint-émilionnais.
En 1987 je reprends mes études : I.U.T des Métiers du Livre ainsi que la formation de bibliothécaire.
Pendant un an, je diffuse des petits éditeurs dans les bibliothèques de vingt-sept départements.
De 1988 à 1995, je suis assistante de direction pour le Salon du Livre de Bordeaux.
Enfin, j’occupe le poste de bibliothécaire-documentaliste d’abord à L’École de Cadres psychiatriques puis au pôle formation de l’hôpital Charles Perrens.
Depuis dix ans, j’anime un blog, Les Tempes du temps : c’est ma cour de récréation.
Depuis huit ans, j’anime également des séances de travail avec des handicapés (surtout visuels) sur l’écriture et la lecture et des ateliers avec des enfants où nous « fabriquons » des haïkus.
J’allais oublier : j’aime passionnément la musique.
Bibliographie
- Dernières lettres à ma mère – Thomas Méneret – Édition établie et préfacée par
Claire Massart – Pleine Page, 2009 (Détour du silence)
Lettres que mon fils Thomas m’a adressées durant les quelques mois qui ont précédé sa disparition en 2007. Préface et postface Claire Massart. Ce texte a été mis en scène à Montréal (Québec) par Marie-Louise Leblanc en 2011 sous le titre La Maison des Souffrants. - L’Herbe bleue – photographies Clarisse Méneret-Massart – Ambodexter, 2009
Dix textes pour célébrer le Bassin d’Arcachon - Six petites perdrix – Le Greffier, 2010 – Poèmes et haïkus
- L’oubli des étangs – Le Greffier, 2014 – Poèmes suivi de Après, l’Invisible…
- L’aveu des nuits suivi de Le calendrier oublié – Éditions des Vanneaux, 2017 (L’Ombellie)